Benhard Schlink : La petite fille
Daniel Ducharme | Romans étrangers| 2025-07-01
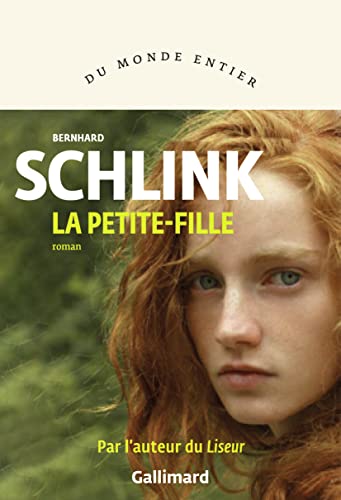 Kaspar et Birgit forment un couple depuis de nombreuses années. Un jour, en rentrant de la librairie où il travaille (en fait, il est en le propriétaire), Kaspar trouve sa femme morte dans la baignoire. Une surdose d'un médicament qu'elle prenait occasionnellement pour atténuer son anxiété. Birgit a toujours eu un comportement atypique. Écrivaine, elle pouvait s'enfermer pendant des heures dans un petit bureau que le couple avait aménagé dans la mezzanine de leur appartement. Écrivaine, elle l'était, même si elle n'avait rien publié depuis des années. Dans son bureau, Kaspar tombe sur des lettres d'un éditeur qui souhaite publier ses poèmes. Étonné, il lui écrit le lendemain, et celui-ci lui répond rapidement : il aurait voulu publier ce recueil en attendant le manuscrit que Birgit lui avait promis. Quel manuscrit ? Kaspar ne sait rien de tout ça. Dans ce petit bureau, il y a un ordinateur. Avec l'aide d'un informaticien, il réussit à l'ouvrir. Sur le disque dur, il découvre un roman inachevé, un texte qui décrit les recherches de Birgit pour retrouver sa fille… Un choc pour Kaspar qui ignorait un pan complet de l'existence de Birgit en Allemagne de l'Est. Après avoir lu le manuscrit, il décide de reprendre la recherche là où Birgit l'avait arrêtée. Et cette quête à travers de nombreux villages de l'Allemagne de l'Est constitue la deuxième partie de ce beau roman.
Kaspar et Birgit forment un couple depuis de nombreuses années. Un jour, en rentrant de la librairie où il travaille (en fait, il est en le propriétaire), Kaspar trouve sa femme morte dans la baignoire. Une surdose d'un médicament qu'elle prenait occasionnellement pour atténuer son anxiété. Birgit a toujours eu un comportement atypique. Écrivaine, elle pouvait s'enfermer pendant des heures dans un petit bureau que le couple avait aménagé dans la mezzanine de leur appartement. Écrivaine, elle l'était, même si elle n'avait rien publié depuis des années. Dans son bureau, Kaspar tombe sur des lettres d'un éditeur qui souhaite publier ses poèmes. Étonné, il lui écrit le lendemain, et celui-ci lui répond rapidement : il aurait voulu publier ce recueil en attendant le manuscrit que Birgit lui avait promis. Quel manuscrit ? Kaspar ne sait rien de tout ça. Dans ce petit bureau, il y a un ordinateur. Avec l'aide d'un informaticien, il réussit à l'ouvrir. Sur le disque dur, il découvre un roman inachevé, un texte qui décrit les recherches de Birgit pour retrouver sa fille… Un choc pour Kaspar qui ignorait un pan complet de l'existence de Birgit en Allemagne de l'Est. Après avoir lu le manuscrit, il décide de reprendre la recherche là où Birgit l'avait arrêtée. Et cette quête à travers de nombreux villages de l'Allemagne de l'Est constitue la deuxième partie de ce beau roman.
Son enquête l'amène à se présenter un jour dans une maison d'un village de l'ex RDA, là où habitent Svenja, la fille de Birgit, son mari Bjorn, et leur fille, Sigrun. Pour bien saisir le contexte du roman, il faut savoir que ceux-ci font partie de la communauté des Völkisch, une colonie qui regroupe des nationalistes allemands, assez proches de l'idéologie nazi. Il semblerait que ces communautés soient toujours présentes dans certaines régions de l'ex RDA, des laissés-pour-compte de la Réunification, qui ont vite fait de sombrer dans le complotisme, la xénophobie, la haine de l'Ouest. Kaspar connaît assez peu les milieux de l'extrême droite, tout comme ceux de l'extrême gauche, d'ailleurs.
Aux parents, Gaspar prétend que Birgitt avait laissé le quart de ses revenus à Svenya, une offre assortie de conditions spécifiques, notamment de recevoir à Berlin la petite fille, Sigrun, pour quelques semaines pendant les vacances et ce, deux fois par année. Les parents acceptent, plus ou moins attirés par l'appât du gain qui, parfois, s'avère plus fort que les idéaux... Sigrun a quatorze ans et elle est pétri des idées d'extrême droite de ses parents, mais petit à petit, elle tisse un lien avec Kaspar, son grand-père par alliance, car on a déjà compris qu'il n'est pas le père biologique de Svenja.
Et voilà l'essence de ce beau roman : comment un grand-père, un libraire d'Allemagne de l'Ouest, ayant toujours vécu dans une démocratie libérale, réussira à nouer une relation suivie avec une jeune adolescente, éduqué en Allemagne de l'Est par des parents issus d'une communauté pétrie d'idées, disons extrêmes, même si ça ne suffit pas vraiment à définir ce qui l'anime ? La relation, un peu forcée au début, en raison d'un accord quasi financier conclu avec les parents, s'installe petit à petit au fils des mois, malgré quelques dérapages comme en témoigne cette remontrance de Kaspas à Sigrun :
Crois-tu que si vous incendiez ma voiture parce que je ne vends pas de bons livres, j’arrêterai ? C’est quoi, toutes ces âneries, Sigrun ? La vie est ailleurs. La vie, c’est la musique et le travail. Fais des études, apprends quelque chose aux enfants, soigne des malades, construis des maisons ou donne des concerts – tu es intelligente, tu es forte, fais-en quelque chose. Personne ne reprendra la Prusse-Orientale et la Silésie. L’Allemagne ne deviendra pas plus grande, mais elle n’est pas trop petite, et ses coutures ne craquent pas par la faute des immigrés.
Cette relation n'est pas évidente comme on s'en doute. Une des clés du succès de la réussite du projet de Kaspar (une sorte de réhabilitation de la jeune fille ?) repose sur la culture, notamment sur la musique puisque Sigrun suivra des leçons de piano chez Kaspar. Mais ce succès est fragile quand on sait que nul n'échappe à son milieu. En fait, pour y échapper, il faut carrément s'en extraire, le plus loin possible, si possible… Mais ici je préfère me taire, sinon je risque de dévoiler la conclusion de ce roman que je vous laisse découvrir.
À l'ère des communications, jamais il aura été plus difficile à des milieux distincts de s'interpénétrer. C'est le grand paradoxe de notre siècle. Bernard Schlink, dans La petite fille, essaie de le faire. S'il ne pouvait rien pour la fille, il a tenté le coup avec la petite fille. À vous de mesurer s'il parvient à répondre à certaines questions dans son roman. Pour ma part, cela confirme à nouveau que, parfois, on en apprend plus en lisant des romans qu'en se coltinant des essais savants.
Schlink, Benhard. La petite fille / traduit de l'allemand par Bernard Lortholary. Gallimard, 2023