Iida Turpeinen - À la recherche du vivant
Daniel Ducharme | Romans étrangers| 2025-10-01
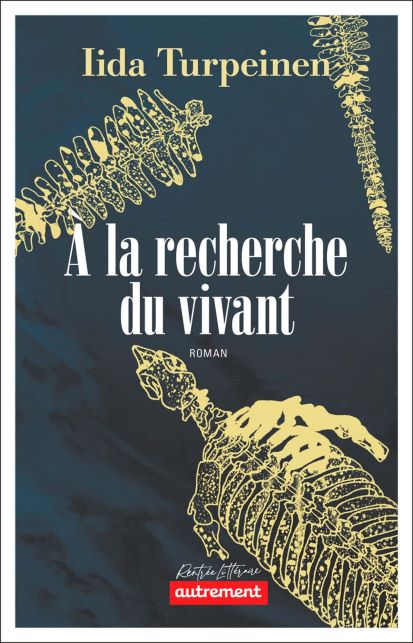 Ce roman est pour moi la grande surprise de l'année 2025. Pour être honnête, je n'avais pas lu un aussi bon roman depuis Poussière dans le vent de Leonardo Padura et Leçons de Ian McEwan. Toutefois, aucun dénominateur commun entre ces trois œuvres. En revanche, ce roman finlandais atypique m'a fait immédiatement penser à un autre roman, québécois celui-là, et tout aussi atypique : L'usage des étoiles de Dominique Fortier. Dans les deux cas, on recourt à des procédés narratifs variés (narration omnisciente, extraits de journaux, passages de carnets de notes, correspondance). Dans les deux cas, il est question de la vie de savants, doublés d'aventuriers animés par une quête du savoir et ayant trouvé la mort loin de chez eux, au milieu d'une nature hostile. Puisque nous sommes dans le comparatif, les deux auteurs sont des autrices ou des écrivaines, si vous préférez. Deux femmes, donc, même si cette constatation a peu d'importance dans le présent contexte.
Ce roman est pour moi la grande surprise de l'année 2025. Pour être honnête, je n'avais pas lu un aussi bon roman depuis Poussière dans le vent de Leonardo Padura et Leçons de Ian McEwan. Toutefois, aucun dénominateur commun entre ces trois œuvres. En revanche, ce roman finlandais atypique m'a fait immédiatement penser à un autre roman, québécois celui-là, et tout aussi atypique : L'usage des étoiles de Dominique Fortier. Dans les deux cas, on recourt à des procédés narratifs variés (narration omnisciente, extraits de journaux, passages de carnets de notes, correspondance). Dans les deux cas, il est question de la vie de savants, doublés d'aventuriers animés par une quête du savoir et ayant trouvé la mort loin de chez eux, au milieu d'une nature hostile. Puisque nous sommes dans le comparatif, les deux auteurs sont des autrices ou des écrivaines, si vous préférez. Deux femmes, donc, même si cette constatation a peu d'importance dans le présent contexte.
Mais là s'arrête la comparaison. car, contrairement à L'usage des étoiles de Dominique Fortier, qui relate une tranche de vie de l'explorateur John Franklin (1786-1847), mort au milieu des glaces alors qu'il recherchait le passage du Nord-Ouest, À la recherche du vivant de Iida Turpeinen met en scène de nombreux personnages, la plupart ayant réellement existés, et ce à différentes époques, en fait de 1741 à nos jours, personnages qui tournent tous autour de la découverte d'un mammifère marin disparu depuis longtemps : la vache des mers.
En première partie, Turpeinen raconte l'expédition du capitaine Vitus Béring (1681-1741), mort sur cette île qui porte son nom, au milieu du détroit nommé aussi en son honneur. À son bord, Georg Wilhem Steller (1709-1746), mort aussi loin de chez lui, dans un village de Sibérie, alors qu'il venait de découvrir la vache des mers, nommée par la suite la rhytine de Steller en son honneur. C'est d'ailleurs sur ce naturaliste que se penche l'auteure dans la première partie de roman qui a les allures de récit scientifique.
Après avoir narré la déroute de Steller, Iida Turpeinen nous transporte, plus de cent ans plus tard, dans l'Alaska russe alors que Johann Hampus Furuhjelm (1821-1909) vient d'être nommé gouverneur. Il est affecté à Novo-Arkhangelsk, capitale de ce territoire. L'auteure décrit alors la vie difficile du gouverneur, de sa femme, de sa sœur et des quelques Européens qui gravitent autour d'eux, souvent des Russes, Finlandais, Suédois et Allemands au service du tsar de Russie. Une de ces personnes, Constance, la sœur épileptique de Furuhjelm, passe ses journées dans la salle où est consignée la collection zoologique du manoir. Inquiet pour l'avenir de la colonie (pour rappel, l'Alaska sera vendue aux États-Unis moins de vingt ans plus tard), il cherche désespérément un moyen de rehausser sa valeur économique aux yeux des autorités russes. Or, un jour, des autochtones (des Aléoutes, plus précisément) trouvent, sur une île de la mer de Béring, un squelette de la vache des mer, un artéfact qui a pris une valeur considérable depuis l'extinction de cette espèce, à peine trente ans après sa découverte par Steller. En contact avec le botaniste finlandais (suédophone et sujet de l'empire russe), Alexander von Nordmann (1803-1866), il lui envoie le squelette de la rythine de Steller qu'il estime être celui-là même qu'aurait enterré Steller, ne pouvant l'apporter avec lui au moment de quitter l'île de Béring sur un bateau de fortune. Furuhjelm mourra en Alaska peu de temps après sa sœur, Constance, qui a identifié un par un les os du squelette, tandis que sa femme, Anna, retournera finir ses jours en Suède avec ses enfants.
Ensuite, l'autrice nous transporte quelques années plus tard en Finlande, à l'Université impériale de Helsinki où nous retrouvons le botaniste et zoologiste Alexander von Nordmann qui, pour dessiner les insectes, surtout les araignées, en fait, s'adjoint une dessinatrice, Hilda Olson. Ensemble, entre deux recherches, ils parviendront à assembler le squelette de la vache des mers, travaux qui seront complétés, près de cent ans plus tard, en 1950, par une autre personnalité atypique, John Grönvall, À la fin du roman, nous nous retrouvons en 2023, dans une brève scène au Musée d’histoire naturelle Helsinki, où des scientifiques s'efforcent, par des manipulations génétiques, à recréer la vache des mers. Et c'est par ces paroles, dignes de la sagesse antique, que Iida Turpeinen conclue son roman : "Ce qui est mort, on ne peut plus le retrouver, mais on peut en avoir une idée, un espoir, une copie fidèle – peut-être est-ce suffisant".
Serez-vous sensible à la lecture de ce roman qui tourne autour de cette vache des mers, un animal immense et gentil qui n'a pas survécu plus de trente ans après sa découverte ? Chose certaine, si vous n'êtes pas sensible à l'extinction des espèces, vous le serez sans doute un peu plus après avoir lu ce livre qui, à mon humble avis, s'avère un grand roman par son originalité, tant par le sujet que du traitement que l'écrivaine en fait.
Turpeinen, Lida. À la recherche du vivant / trad. du finnois par Sébatien Cagnoli. Autrement, 2025